Par l’intermédiaire d’une relation commune, j’ai rencontré il y a trois mois environ une amie qui écrit de la poésie. Si nos textes sont de genres et de styles bien différents, nous avons cependant souhaité les faire se rencontrer pour une lecture à voix haute. Jeudi 18 juin 2015, nous avons donc reçu chez moi une quinzaine d’amies pour une rencontre et un partage amicaux.
Si j’ai déjà eu la chance d’entendre certains de mes poèmes dits par des voix amies, lors notamment du Printemps des Poètes 2014 et 2015, pour Christine, c’était la première fois qu’elle dé-voi-lait ses poèmes. Pour l’avoir vécu moi-même, je sais que ce moment est toujours empreint d’émotion. Par ailleurs, c’était pour moi l’occasion de présenter certains des poèmes de mon dernier recueil, Mais l’ancolie… qui vient de paraître chez Mon Petit Editeur.
Aucune thématique particulière n’a présidé à l’ordonnancement des poèmes choisis. Nous les avons simplement disposés en fonction des échos qu’ils ont suscités en nous et des associations qu’ils ont fait naître. Dans l’alternance, la succession ou l’union de nos voix, les poèmes se sont donc succédé deux par deux, les Gymnopédies d’Erik Satie venant en intermède afin d’apporter une respiration bienvenue entre les textes.
Depuis Apollinaire, on sait que « Sous le pont Mirabeau/ Coule la Seine/ Et nos amours… ». « Au fil de l’eau » (Christine) nous a dit d’abord le temps qui passe, la danse de la vie :
Je t’ai vu grandir
Je t’ai vu grossir aussi
J’ai aperçu tes cailloux
Tes genoux dans l’eau claire de la source
« Sourcier » pourquoi te cacher
Puisque tu as trouvé
Le bonheur « au fil de l’eau » […]
« A la verticale de l’été » a été écrit alors que je venais de voir le film éponyme du Viêtnamien Anh Hung Tran qui raconte le destin de trois sœurs :
A la verticale de l’été
Trois femmes se déploient
Souples corps de lianes
Orbe bombée de leurs paupières
Sous leurs obscurs cheveux de nuit […]
Avec le poème « Cadeau de la vie » (Christine), il s’agit tout simplement de rendre grâce en une forme de « magnificat » :
[…] Attendre
Attendre longtemps
Ce bien si précieux
Source qui coule
Dans nos veines
Sans trop de peine […]
« Le ciel est bleu il fait du vent » m’a été inspiré le 3 juin 2012, un jour de Fête des Mères :
[…] Le brun le blond la douce infante
Se sont enfuis comme eau courante
Le ciel est bleu il fait du vent
Où sont partis mes trois enfants
Miennes amours infiniment
« Entre passé et avenir, nous ne possédons que le petit instant présent. » « Une pensée peut-être » (Christine) évoque la beauté de l’instant :
Heure exquise
Etape requise
Espace glycine
Couleur mauve bleutée
Un peu violette
Une pensée peut-être […]
« Métamorphose » est un poème qui m’a été inspiré par le vol léger d’un papillon ; il reprend le thème de Psyché :
[…] Doux rêve flottant
Mystérieux moment
Mon âme qui ose
Sa métamorphose
La faculté de choisir est sans doute l’expression de notre liberté. Le poème « Aimer choisir » (Christine) dévoile la difficulté du choix :
Aimer à l’envers
De travers
Sous couvert
Aimer droit
Aimer cœur
Aimer Vers […]
Dans La Folle allure, Christian Bobin écrit : « Tu sais ce que c’est la mélancolie ? Tu as déjà vu une éclipse ? Eh bien c’est ça : la lune qui se glisse devant le cœur, et le cœur qui ne donne plus sa lumière […] ». « Mais l’ancolie… » (qui est le titre de mon dernier recueil) propose un jeu avec les syllabes du mot « mélancolie » :
Elle
L’amie innée
La lente liane
A l’élan las
La mal-aimée
L’ancolie calme
Ame en allée […]
« Attentat » (Christine) est un texte écrit à chaud (puis revisité) après les attentats de janvier 2015. Il exprime la surprise devant le mal du monde :
Attenter à la vie
Ici
Devant Lui
Lui l’autre
Pense
Fait la guerre
Guerre du papier du dessin
Guerre du feu […]
J’ai écrit « Le cœur à Ground Zero » au lendemain du 11 septembre 2011, dix ans après la destruction des tours jumelles. J’avais vu en effet un reportage télévisé qui évoquait la souffrance toujours vive de ceux qui y ont perdu un être cher :
[…] Là
C’est désormais le creux
Rectangulaire
Celui de la douleur
Où pleurent
Les eaux du souvenir
Et où celui qui reste
Avec un papier calque
Vient retrouver
Vient caresser
Vient réécrire le nom
De celle qu’il aima
Le cœur à Ground Zero
« Ecrire » (Christine) suggère la joie de la lecture et de l’écriture :
[…] Une pensée
Une ligne sur le papier
Un stylo levé
Dressé pour mettre un frein à son destin
[…] Ecrire
Un essaim
Le dessin de l’écriture
« Ecrire en ce jardin », composé au cours d’un atelier d’écriture (animé conjointement par un poète et une haptonomiste), suggère que la joie du cœur, née de la joie du corps, est une voie possible vers l’écriture :
«Tiens ! Peut-être… Pourquoi pas ?
Diseuses, les larmes au bord de mes paupières ?
Quoi ?
Dans ce labyrinthe de mots et de feuilles
Qui tombent comme neige
Peut-être… […]
Ecrire en ce jardin
« Bijoux » (Christine) et « Dans ta robe flammée » (Catherine) sont deux poèmes dont le premier pourrait être une offrande au second :
Beauté à genoux
Biseautés
de petits clous
Brillantés de pierres précieuses […]
A genoux dans les Cieux
« Dans ta robe flammée », c’est Marie-Madeleine, revêtue d’une éclatante robe jaune, dans un tableau de Theodor van Thulden, qui la représente au pied de la Croix :
Toi Marie-Madeleine pénitente exaltée
Arrosant de tes pleurs les pieds de l’Inspiré […]
Que n’avais-tu songé dans ta robe flammée
Qu’un jour Il te dirait Noli me tangere
« Ce qui compte, c’est la puissance de la joie qui éclate à la vitre de nos yeux. Une apparition, une seule, et tout est sauvé » écrit Christian Bobin dans L’Homme-joie. « La joie » (Christine) et « Echappée belle » (Catherine) sont deux poèmes consacrés à la joie, sentiment de liesse et de plénitude : une joie à retrouver et une autre qui naît de la surprise :
Sur la table
Allongée dans le sable
Dans les ruelles de l’étage
Inférieur de ton être
La joie est là […]
Sur le sable
Fin léger
Une pensée furtivement
Se glisse
Des petits grains
S’enkystent
La joie revient
Et la joie de naître au moment où l’on s’y attend le moins :
La cascade surgie des rochers tortueux
Le soleil qui tombe à l’envers de la mer
Le lever de perdreaux par-dessus les maïs
Le cheval hennissant en dehors du licol […]
Sublime et frêle
Irrationnelle
Providentielle
Telle est rebelle
En sentinelle
Toujours nouvelle
L’échappée belle
Dans L’éternité n’est pas de trop, François Cheng écrit : « Puisque la beauté est rencontre, toujours inattendue, toujours inespérée, seul le regard attentif peut lui conférer étonnement, émerveillement, émotion, jamais identiques. » « Merveille des merveilles » (Christine) en est l’illustration :
Touché en plein cœur
L’odeur du bonheur
Délirante de douceur
Se dessine dans l’herbe grise
De ton sourire
Merveille des merveilles […]
Assis là
Raconte-moi
De surcroît
L’étendue saugrenue
De l’immensité du bonheur
De te trouver « Emerveillé »
Qui ne connaît Les Très riches heures du duc de Berry qu’illustrèrent les frères de Limbourg, Pol, Hermann et Jannequin ? « Jean et Ursine » est un poème qui m’a été inspiré par une de leurs merveilleuses enluminures, « L’homme zodiacal » :
Ô vous ma belle Ursine dont le corps est d’ivoire
Et dont les cheveux d’or sont reflets de soleil
Vous ma céleste sœur ma jumelle-miroir
Je vous ferai captive dans l’orbe des merveilles […]
Du Zodiaque absolu le temps viendra toujours
Et j’y ajouterai l’ours noir et le cygne
Gémeaux nous brillerons à l’éther de l’Amour
Dans la constellation seront Jean et Ursine
Les deux poèmes qui suivent pourraient être lus dans les lignes de la main ; ils sont comme deux lignes de vie. Le premier est intitulé « Advenir » (Christine) et le second « Ma vie » :
Venir avec
Naître
Jamais seul
Ici
Là
Toujours […]
Avenir serein
Avenir certain
Mentalement
Avènement
J’ai écrit ce poème, « Ma vie », en pensant aux toiles du peintre scandinave Vilhelm Hammershøi. Il peint des intérieurs blancs où se succèdent des portes ouvertes :
Ma vie
Une marche tout au long de couloirs
Blancs
Où des portes s’ouvrent
Sans bruit […]
Ma vie
Une avancée dans les sables mouvants du temps
Comme dans un tableau déchiré
De Vilhelm Hammershøi
" Tout objet aimé est le centre d'un paradis" affirmait le poète romantique allemand Novalis. Les deux poèmes qui suivent, « Bien-être » (Christine) et « S’il est un paradis » (Catherine) disent chacun un instant délicieux de paix et de béatitude :
Etre bien
Etre là
Assis
Dans l’instant
Etre aussi
Avec toi
Avec moi
Avec Lui
Dans l’instant […]
Etre là
Bien-être
Etre bien
« S’il est un paradis » a été écrit après ma visite des merveilleux jardins du palais Viana à Cordoue.
S’il est un paradis
C’est le palais Viana
Où sans fin à l’envi
Je mènerai mes pas
Aux patios parfumés
Où jase à l’infini
Clair et jamais lassé
Le tendre chuchotis
Des fontaines [z] aux losanges
Qu’enivre et que ravit
La senteur des oranges
"Le noir est le refuge de la couleur" disait Gaston Bachelard. Les deux poèmes qui suivent, « Gant noir » (Christine) et « Walpurgis » (Catherine) évoquent deux connotations de la couleur noire :
C’est un rêve galant
Un gant tendu
Noir […]
C’est noir pourquoi
C’est noir pour croire
En Toi
C’est noir pour dire
Que tu es là
C’est noir pour Toi
La nuit de Walpurgis est une fête néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée clandestinement dans toute l'Europe, elle fut identifiée au sabbat des sorcières et c’est cela qui m’a inspirée :
J’ai entendu des aboiements
C’était Hécate et ses grands chiens
Qui s’en venaient sur le chemin […]
J’ai rêvé la nuit des sorcières
Porte béante des Enfers
La lune ne s’est pas levée
Dans l’Antiquité, les mirabilia, ce sont les choses extraordinaires. Mais l’extraordinaire, le merveilleux, n’est-il pas partout pour qui sait s’étonner et admirer ? Les poèmes « Les merveilles » (Chistine.) et « Pour des prunes » (Catherine) illustrent cette faculté du regard naïf :
Peut-on parler de merveille
A un être surdoué
Peut-on parler de merveille
A l’oiseau enchanté […]
Peut-on compter merveille
A qui aime la pâtisserie
Petite merveille
De notre enfance
Réjouis-toi d’être un délice
Pour la langue et le palais
Et puisque nous étions dans la confiserie… nous y sommes restées en faisant des confitures de prunes !
Pruniers en ligne
Dans l’été qui meurt
En meules de foin
Et vignes mûries […]
Alchimie du feu
Et transmutation
Rondeurs lie-de-vin
En sirop lilas
Géométrie calme
Des pots bien rangés
Sur les étagères
Tout ça pour des prunes !
" Le poète, c'est l'homme attentif à des riens" disait Jacques Chardonne dans une « Lettre à Roger Nimier ». « Poète en herbe » (Christine) nous le dit aussi :
Avenir incertain
Mais divin
C’est pour Toi
Poète de surcroît […]
Poésie recouverte
Poésie étroitesse
Oblige la poétesse
A transmettre
Sans le couvercle
Le délice du dedans
Poète en herbe
Poétesse qui désherbe
Selon moi, l’écriture d’un poème se réalise souvent dans un dialogue intime avec soi-même et loin du monde. Elle naît dans « Les terres de ma solitude » :
Dans les terres de ma solitude
Les empreintes de mes pas ont disparu
Le son de ma voix a décru […]
Dans les confins de ma solitude
Je me love aux tréfonds de moi-même
Pour que bruisse farouche un unique poème.
Le canapé est un objet prosaïque du quotidien. Mais il peut inspirer le poète ! Confortable, il a suggéré à Christine « Un rêve sur canapé » :
Assise reposée
Heureuse
Soirée délicieuse
Profiter
Bonheur approuvé
Un rêve sur canapé […]
Porteur de rêves
Sur canapé allongé
Le poème « Couchée » (Catherine) est une rêverie sur tout ce temps de la vie où l’on est allongé…
La nacelle d’osier où l’on me déposa
Et le petit lit bas de l’enfance muette
Le si grand lit carré de la jeune mariée
Une ancienne chanson […]
Il y aura un temps
Je les retrouverai
Je m’y endormirai
Dans mon lit de verdure
Les peintres savent bien que la peinture est toujours une forme de tempête et d’orage. Le poème « Peindre » écrit par Christine, elle-même peintre, s’attache à le dire :
Si joliment posé
Là sur la toile
Le dessin de la vie
L’émotion du moment
Peindre à l’encre bleue
De tes yeux
Peindre en simple lieu
De tes creux de mains […]
Peindre souvent dans le vent
Sous la pluie à midi
Juché sur un lit au milieu des Iris
Mais peindre « peindre » encore les Myosotis
« Regard dans La Tempête » est une songerie sur la toile du Giorgione, La Tempête, qui est un de mes tableaux préférés :
Je suis
A Venise à L’Académie
Devant
La Tempête du Giorgione
Sur des cieux d’un bleu de cobalt
Tel un serpent brille un éclair
La ville blême s’illumine
Un oiseau rit sur un toit gris
Des feuilles dansent au firmament
Des arbres verts vibrent au vent
Un pont de bois regarde l’eau
Des ruines crient leur solitude […]
Et moi
Je voudrais m’ensommeiller là
En l’intime des éléments
Dans ce lieu vert et utopique
Etre la femme et son enfant
Que l’homme enfin regarderait
De son œil d’amant lumineux
Sous le plombé d’un ciel d’orage
“La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir » disait Léonard de Vinci. Peinture et poésie ne sont-elles pas deux manières de célébrer la beauté du monde ?
Avec cet écho pictural s’est achevé ce moment poétique, qui nous a permis à Christine et à moi-même de lancer notre modeste appel du 18 juin en faveur de la poésie.




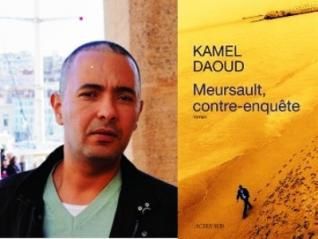
/http%3A%2F%2Fwww.livredepoche.com%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fstyles%2Fcover_book_focus%2Fpublic%2Fmedia%2FimgArticle%2FLGFLIVREDEPOCHE%2F2015%2F9782253112754-T.jpg%3Fitok%3DX0MxVdv0)








/image%2F1488802%2F20160916%2Fob_f2a21b_catherine-thevenet-photo.jpg)
